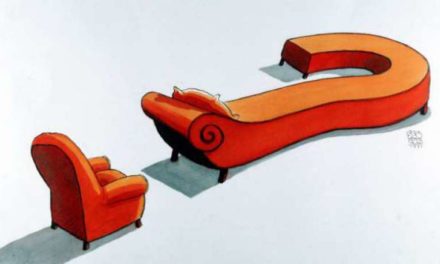L’Institut psychanalytique de l’enfant organise ce samedi 18 mars sa 4e Journée d’étude sur le thème “Après l’enfance” ! Je vous encourage vivement à jeter un œil à leur blog: https://www.apreslenfance.com/
Il est vraiment très réussi et vous y trouverez quelques pépites !
À cet occasion, Christelle Sandras, qui fait partie du comité d’organisation, m’a demandé comment le thème résonnait pour moi…
J’ai d’abord été un peu embêté, qu’aurais-je donc à dire sur l’enfance et même sur l’adolescence ?, moi qui ne reçois que des adultes incarcérés ou après l’incarcération. Je connais peu la clinique avec les enfants…
Et pourtant… L’enfance n’est évidemment pas absente des entretiens avec les détenus, lorsqu’ils veulent bien se prêter à l’exercice de relater leur parcours. Ou plutôt, je dirais que l’enfance est le plus souvent assez absente de leur discours, ce serait un chapitre « sans importance », « sans histoires ». C’est plutôt l’adolescence qui vient comme « grand début » de leur carrière délinquante. Car c’est un fait que la majorité des détenus que je rencontre ont commis leurs premiers faits dès l’adolescence, et même à l’adolescence jeune : 10-12-14 ans !
Lorsqu’ils sortent de la famille, ils vont vers les pairs, leur nouvelle boussole. Comme disait l’un d’eux « j’ai cherché dans les bandes du respect », soit ce que l’on est traditionnellement en droit de trouver dans sa famille. Le moment délicat de la séparation avec celle-ci indique quelque chose de ce qu’ils n’ont pu y trouver, soit une certaine ouverture au désir, une transmission d’une confiance, d’un respect, qui permet de tracer son chemin en dehors de la famille. Perdant les règles ayant eu cours dans leur famille, parfois de simples énoncés normatifs qui ne leur « parlent » pas, ils ne parviennent pas à trouver une orientation ailleurs que dans l’identification aux frères, aux semblables de la bande, dans une logique de comparaison et d’escalade symétrique dans la violence. Identification aussi aux « grands » de la bande, qui « gagnent beaucoup d’argent très rapidement ».
Quand on les interroge sur le pourquoi de leurs actes délictueux, beaucoup disent, de manière très générale, « c’est les fréquentations ». Là où, pour d’autres, l’école vient prendre le relais de la famille, c’est la rue et la bande qui viennent structurer leur avenir, dans une logique qui mène parfois au pire. Certains en viennent à dire « heureusement que la prison m’a arrêté, sinon je serais mort ! ». Mais, en même temps, la prison ne vient pas toujours faire arrêt, il est bien connu que parfois, prenant le relais de la rue, elle est tout autant une « école du crime ».
– Rencontrez-vous des adolescents en prison ?
Je n’y rencontre que des adultes, en détention ou après leur détention. Mais ce sont parfois des adultes fort jeunes qui peuvent avoir 18 ans.
En Belgique, lorsqu’un mineur commet un délit suffisamment grave, le juge de la jeunesse peut décider de le placer dans une IPPJ (institution publique de protection de la jeunesse). J’ai eu l’occasion d’en visiter une, à Everberg. Cela ressemblait tout de même beaucoup à une prison, sauf que le discours y était plutôt éducatif, centré sur le comportement et réduit à une logique récompenses/punitions.
Le principe fédérateur des IPPJ est une attitude générale vis-à-vis du jeune. Individuellement, l’axe éducatif consiste à mettre en évidence les points à améliorer dans le comportement mais aussi à pointer les éléments positifs sur lesquels le jeune pourra s’appuyer pour se reconstruire une image personnelle moins stigmatisée.
http://www.aidealajeunesse.cfwb.be/index.php?id=632
Beaucoup des détenus que j’ai rencontrés sont passés par ces IPPJ, cela fait presque partie du parcours classique d’un délinquant ordinaire.

– Les détenus évoquent-ils avec vous ce moment d’après l’enfance ?
Sauf quelques cas de grandes violences, et parfois quelques signes discrets de décrochage (« Quand j’étais enfant, je n’étais pas imprégné par ce qu’il se passait autour de moi »), force est de constater que l’enfance est souvent absente de leur discours et de leurs préoccupations. D’une part, parce qu’ils sont, de manière générale, peu enclins à parler avec un psy (la majorité des détenus sont contraints à voir un psy pour pouvoir bénéficier d’une libération anticipée) ; ils n’y voient pas d’intérêt : ils ne sont pas fous, n’ont pas de problème mental, alors pourquoi se plier à l’exercice de parler de son enfance ? D’autre part, parce qu’ils ont sans doute fort peu à en dire, et que peu de choses d’ailleurs leur ont été transmises à ce sujet.
Lorsqu’ils veulent bien se prêter à l’exercice de raconter leur parcours, c’est le plus souvent « les premières conneries » qui viennent en place de premier souvenir. C’est souvent fort tôt que ces faits fondateurs de leur histoire surviennent : 10-12-14 ans, soit ce moment où ils quittent le monde familial de l’enfance pour entrer dans celui des pairs où sévissent l’influence des autres et l’escalade symétrique de qui fera le pire (« Je faisais des faits de fous »).
Et s’ils ne se reconnaissent pas avoir un « problème mental », c’est que c’est le signifiant « délinquant » qui leur colle à la peau et fonde leur histoire judiciaire, la seule qu’ils ont parfois à transmettre. Tout au plus reconnaissent-ils un problème de comportement, de dépendance à une substance, des actions qu’ils ne peuvent s’empêcher de répéter.
Dans ce moment de la vie où les identifications sont en cours de constitution, certains adolescents se saisissent des signifiants de la loi pour se représenter auprès de l’Autre et couler l’énigme de leur vie dans des signifiants juridiques. La jouissance est alors en quelque sorte traduite dans le système signifiant qu’est le code de loi. Je suis frappé de constater à quel point la fiction juridique est, pour certains, la seule histoire qu’il leur est possible de transmettre.
Ce que les criminologues appellent « la criminogenèse » se révèle être la genèse de leur identité ou, en tout cas, d’un certain mode de jouir que peut devenir « le monde des conneries ».

Jacob Riis – Bandits Roost off Mulberry St – 1887
– La prison peut-elle avoir une fonction pour ces jeunes ?
Tout d’abord, la prison vient faire point d’arrêt à quelque chose qui peut être perçu, après-coup, comme illimité : « J’ai commencé petit, des petits vols, des bêtises, puis des braquages de plus en plus violents, des règlements de comptes… Mais aussi les sorties, la drogue… L’argent me brûlait les doigts, j’en voulais de plus en plus… Si la prison n’avait pas été là, je serais mort ».
Lorsqu’une architecture subjective minimale ne tient pas, le sujet peut se voir précipité dans l’illimité de la jouissance, sa difficulté propre devenant alors un problème de sécurité publique. L’architecture carcérale vient alors suppléer aux limites subjectives manquantes, en posant des murs réels, des bords, un « ordre de fer ». La prison fonctionne ainsi comme mise à distance de ce qui générait la jouissance. Certains jeunes en viennent à compléter leur « je suis mal parce que je suis en prison » par un « mais à l’extérieur, c’est pire… ».
La prison a également effet de faire consister un Autre particulier, celui de l’administration pénitentiaire. Toute demande, tout déplacement du détenu sont soumis aux circuits de l’Autre judiciaire : procédures, billets de rapport, avocats, juges, tribunaux, etc. C’est comme si le hors-la-loi était pour eux la seule manière d’entrer dans le monde du droit.
Pour des sujets sans boussole, ou qui n’ont pas d’adresse, étrangers à leur propre vie, le rythme propre à la prison, les règlements, les contacts avec les autres détenus et les gardiens sont autant de formes qui peuvent leur fournir « une vie mode d’emploi » et une pacification temporaire. Le contact avec les « travailleurs du droit » (juge de la jeunesse, assistants de justice, policiers…) peut aussi avoir son importance ; comme me disait ce matin un jeune détenu : « Le commissaire Patrick, je le voyais comme mon père, il a enquêté sur moi, il m’a arrêté quand il devait m’arrêter… ». Les travailleurs du monde judiciaire peuvent venir comme famille de substitution, comme une référence dans le discours, dans une recherche d’un Père qui tient, fut-il vécu parfois de manière capricieuse. Certains détenus se plaignent d’être passés de celui qu’ils appelaient « Mon juge (de la jeunesse) » à l’anonymat d’ « un juge » quand ils sont devenus adultes.
Car si la prison est un lieu malade, elle n’en reste pas moins pour certains le seul lieu praticable. Cela surprend parfois, mais certaines personnes se montrent mieux intégrées en prison qu’à l’extérieur. Elles y travaillent, s’organisent en fonction de ses exigences, y créent des liens plus apaisés. La prison répond parfois à un impossible d’habiter ailleurs, de s’inscrire quelque part ; elle s’intègre dans un circuit famille-prison-famille-prison… Mais elle n’est thérapeutique qu’en apparence, car elle ne propose que peu de solutions exportables : dans un monde où on leur demande d’être, de se mouvoir et de prendre des responsabilités, les anciens détenus se trouvent vite mal, et le retour en prison se profile rapidement.

– Comment s’aborde la question de la rencontre de l’autre sexe pour chacun en prison ?

– Quels liens ont-ils avec leur famille ?


J’ai travaillé durant 12 ans comme psychologue dans un service d’aide aux détenus (prisons bruxelloises de Forest, Saint-Gilles et Berckendael), aux ex-détenus (libération sous conditions, bracelet électronique, congés pénitentiaires, etc.) et à leurs proches.
J’ai créé ce blog pour rendre compte de ce que j’ai appris de ma rencontre avec les prisonniers.

 Intervenir en prison
Intervenir en prison À propos des prisons
À propos des prisons Des criminels / des délinquants
Des criminels / des délinquants Vous m’avez posé vos questions
Vous m’avez posé vos questions Les murs ont des oreilles
Les murs ont des oreilles Grand écran
Grand écran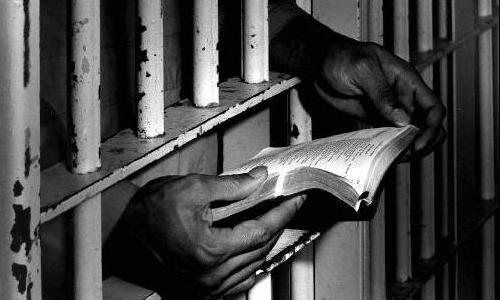 Poètes, vos papiers !
Poètes, vos papiers ! Images/humour
Images/humour Pourquoi ce blog ?
Pourquoi ce blog ? Me contacter
Me contacter D’autres blogs
D’autres blogs