J’ai été contacté récemment par une journaliste de l’hebdomadaire Moustique (l’hebdo qui pique !) pour parler de l’affaire de cette psychiatre française qui a été condamnée il y a quelques semaines après le meurtre commis par un de ses patients. Vous trouverez ci-dessous la discussion que j’ai eue avec la journaliste (dont j’ai oublié de noter le nom :s).
Petit retour sur l’affaire : durant la période 2000-2004, M. Gaillard a été à plusieurs reprises hospitalisé au sein du service de la psychiatre Danièle Canarelli. En 2004, 20 jours après sa sortie de l’hôpital, il tue à coups de hachette le compagnon de sa grand-mère. Déclaré innocent, les enfants de la victime portent plainte contre l’hôpital qui l’a laissé sortir et contre la psychiatre. L’hôpital sera condamné pour négligence et la psychiatre vient d’être condamnée à 1 an de prison avec sursis pour homicide involontaire.
Le « Moustique » m’appelle pour parler de ce qu’est le boulot de psychologue/psychiatre et des limites de notre métier. Peut-on prévoir la dangerosité d’un patient ? Que m’évoque cette affaire ?

La psychiatre Danièle Canarelli
Moustique: « Quel est le boulot du psy avec des patients psychotiques ? »
Notre rôle est d’accompagner le sujet, de se mettre de son côté vis-à-vis des difficultés et impasses qu’il rencontre. Nous avons à « être là », surtout dans les moments de passage qui sont des moments de fragilité. Notre travail implique évidemment d’éviter le passage à l’acte mais notre action comporte le plus souvent d’agir sur ses conditions de survenue. J’ai pu constater que souvent le sujet lui-même a envie d’éviter le passage à l’acte, même si ça lui semble irrépressible. Parfois, cela prend la forme d’un « si vous ne faites rien, je vais faire ça ! » Intervenir, c’est parfois aider le patient à se mettre à distance de ce qu’il vit comme persécuteur, voir avec lui s’il est possible d’interpréter autrement les évènements qui lui arrivent, etc.
« Comment sait-on qu’un patient est dangereux ou non ? »
Les cas les plus clair sont ceux des passages à l’acte annoncés. Il est déjà arrivé qu’un patient me dise qu’il a un projet s’apparentant à un meurtre de masse « pour qu’on se rende compte de ce que j’ai subi, pour qu’on me prenne au sérieux ! » Ce genre de phrase est effectivement à prendre au sérieux et nous avons trouvé ensemble une manière de se faire entendre sans passer par le pire.
Dans d’autres cas, le projet est caché ou bien le sujet ne se l’est pas encore formulé. Il y a néanmoins des choses qu’on peut pré-dire en suivant la logique du cas. On trouve le point où le sujet lâche l’Autre ou se sent lâché par l’Autre. Nous remarquons que souvent le passage à l’acte violent est en fait une réponse à ce qui est vécu comme violent de la part de l’Autre. Les points d’énigme, de perplexité, les mots qui font points de rupture sont aussi à repérer. Il n’y a pas toujours irruption soudaine de quelque chose, il faut parfois repérer les petits détails dans le discours de la personne qui sont hors-sens, hors-dialectique, repérer les moments où le discours se rompt, où surgit une signification personnelle, un début de délire. Par exemple, Andras Breivik, qui a tué plus de 77 personnes en Norvège en 2011, a dit lors de son procès « on veut nous laver le cerveau ! », et c’est en « grand nettoyeur » qu’il est passé à l’acte (J-M Josson, 2013). C’est le genre de certitude qu’il faut prendre au sérieux lorsqu’ils surgissent. Ces éléments sont propres à chaque patient et donc difficilement généralisables. C’est dire l’importance du dialogue avec ces sujets afin de trouver les points de rupture dans la trame de ce qui les portait jusque là. Ceci implique qu’il faut réussir à situer les points d’appui du sujet, qui peuvent d’ailleurs être de petites choses, une place sociale, un idéal, rien qu’un mot parfois -et repérer quand ils sont mis en difficulté.
C’est dans ces moments que les institutions-carrefours sont essentielles, des lieux qui soient prêts à accueillir le sujet au moment où quelque chose devient insupportable pour lui. Malheureusement, les lieux où loger la folie sont de plus en plus mis à mal : il manque cruellement de places d’hospitalisation, la standardisation des pratiques et une rigidification des conditions d’accès entraînent une difficulté pour accueillir ce qui sort du cadre, etc. Aujourd’hui, la volonté politique est plutôt de construire des prisons, où effectivement nous trouvons la folie aujourd’hui. Ou elle se retrouve dans la rue, avec toutes les questions d’insécurité qui en découlent.
« Quelles sont les limites du travail du psy, notamment en ce qui concerne la dangerosité des patients ? »
Bien souvent, la folie vient se loger dans les failles de la société et les grands crimes populaires les mettent à l’avant-plan. Pour utiliser le terme de l’anthropologue Marcel Mauss, cité par Jacques-Alain Miller, “un grand crime populaire est toujours un fait social global” (un fait qui met en branle la totalité de la société et ses institutions). A cet égard, l’affaire Dutroux est emblématique car elle a mis en lumière certaines failles dans l’édifice belge, l’impuissance de l’État à protéger ses citoyens, l’insuffisant suivi des délinquants, les conflits police/gendarmerie, etc.
Mais si ces affaires donnent une idée de ce qui peut être amélioré dans les rouages de la société, ne nous voilons pas la face : il n’y aura jamais de « grand Autre » idéal qui puisse empêcher à tous les coups l’émergence de l’horreur. Et si nous devons sans cesse améliorer notre connaissance et notre savoir-faire, il n’y aura jamais un savoir absolu qui permettra de prédire sans reste les actes d’un sujet, sauf à le considérer comme un robot.
Il y a ce qu’on peut prévoir et ce qu’on ne peut pas : une certaine contingence, le hasard des rencontre, le choix du sujet, … Quand la psychose mène au crime, cela peut être d’une manière totalement déconnectée du sujet. J’ai eu par exemple un patient me disant qu’il avait commis un vol « comme ça, sans raison ». Un autre, inculpé pour meurtre, ne pouvait absolument rien dire de ce qu’il avait fait et attendait même du procès qu’il lui restitue ce qui s’était réellement passé. Il semble d’ailleurs que le patient du docteur Canarelli évoquait une amnésie relative à ses précédentes agressions. Et il faut noter parfois le caractère absolument dérisoire des motivations d’un passage à l’acte violent pour certains patients : il suffit parfois d’un regard, d’un manque de respect… Il arrive aussi souvent qu’un patient cache son délire, de peur qu’on le prenne pour un fou par exemple. Il faut beaucoup de patience pour obtenir sa confiance et qu’il puisse évoquer ce qui l’agite.
« Que pensez-vous de l’affaire de cette psychiatre condamnée en France ? »
Je ne connais pas assez l’affaire pour me prononcer sur le cas de cette psychiatre, qui a fait appel. En attendant les prochaines décisions de Justice, je remarque deux éléments importants qui apparaissent en filigrane.
Notre société questionne régulièrement le psychiatre comme « expert de l’être humain ». Or, dans cette affaire, on touche justement aux limites de l’être humain et donc aux limites de la psychiatrie elle-même. Une certaine idéologie aujourd’hui tend à faire disparaître le paradoxe, l’incertitude : un mot devrait s’égaler à une chose, une cause amener une conséquence de manière directe, univoque. Cette idéologie est vouée à l’échec car l’être humain est un être de paroles et de paradoxes, il n’y a pas de transparence dans notre rapport à nous-même. On n’irait d’ailleurs pas voir un psy s’il était si facile de tout comprendre par soi-même. Certaines choses sont plus fortes que soi, les symptômes, les angoisses, les inhibitions. Le psy a un rôle thérapeutique à exercer en accompagnant l’individu, mais il ne peut pas tout connaître de nos pensées et surtout peut difficilement prédire l’avenir car l’être humain n’est pas entièrement prévisible.

Deuxièmement, et dans le fil de cette question de la prédiction, il me semble qu’il y a dans cette affaire une ligne de fracture entre le juge et l’expert-psychiatre nommé par la cours d’une part et, d’autre part, la psychiatre condamnée et son chef de service qui soutiennent qu’il n’y a pas eu d’erreur commise. Le réquisitoire le plus terrible contre la psychiatre venait en fait de l’« expert ». Il y a ici deux visions différentes qui s’affrontent dans le champ de la psychiatrie : celle du soin et celle de l’expertise. Le but est différent, de même que les pratiques.
L’expert vise à une « science du comportement humain » grâce à une prétendue « objectivation » obtenue par des tests et évaluations. Il voit le patient après le passage à l’acte, souvent dans un état aigu, alors que la psychiatre « de soin » a vu son évolution sur du long terme, dans un état parfois plus compensé. Il y a donc d’un côté comme une photographie d’un point fixe versus une évolution. Or, le procès a pointé ce qui a semblé être un « problème de diagnostic » : la psychiatre avait une hésitation quant à celui-ci et n’était pas d’accord avec ses collègues. Selon l’expert, le juste diagnostic aurait dû être trouvé de manière univoque et cela aurait évité le crime. Mais il faut se rendre compte que ce qui a été pointé comme un « problème de diagnostic » dans le chef de la psychiatre est en fait inhérent au travail des psy. Et contrairement à ce qu’on lit parfois dans la presse, ce n’est certainement pas un défaut : les réunions cliniques, les supervisions et la formation continue permettent de remettre en question de manière continue nos savoirs, de prendre en compte les surprises qui ne manquent pas de survenir lors d’un suivi, l’évolution du patient lui-même. Cette supposée incertitude rend hommage à la complexité du sujet.
L’idéologie dont je parlais un peu plus haut vise plutôt à évacuer toute subjectivité du patient. Certaines théories envisagent en effet le patient en le comparant à un animal ou à un ordinateur. En retour, on a une évacuation de la subjectivité du thérapeute lui-même. On entend parler d’arbres de décision diagnostic, qui pourraient à la limite être administrés par des techniciens rapidement formés. Tout bénef pour le semblant d’objectivité et pour le coût de formation mais cela reste un leurre. Regardez du côté de l’expertise, terme qui semble indiquer que l’expert est par excellence celui qui sait ce dont il parle. Eh bien, avoir trois expertises ayant des conclusions différentes n’est pas une exception lors d’un procès : c’est plutôt la règle.
Notons également à propos du diagnostic de « schizophrénie paranoïde » avancé par l’expert psychiatre, qu’il n’indique en rien l’imminence d’un passage à l’acte : cela dépend beaucoup plus des contingences extérieures et de la position du patient vis-à-vis de ces dernières. Ce n’est pas parce qu’un schizophrène développe des idées paranoïdes qu’il va automatiquement passer à l’acte : certains me parlent de leurs persécuteurs depuis des années et le fait d’en parler met parfois à distance l’acte conclusif. D’autres décident de s’engager dans une procédure de plainte (la Commission des droits de l’Homme devrait être remerciée de donner un cadre légal non-violent à un certain nombre de plaintes paranoïdes !). D’autres encore évitent d’agresser leur supposé agresseur pour en éviter les conséquences (prison, perte de la garde d’un enfant, etc.) Si nous devions garder enfermées toutes les personnes schizophrènes paranoïdes, il faut se préparer à construire de nombreux hôpitaux psychiatriques.
Je rappelle aussi que, légalement, nous avons l’obligation d’avertir les autorités uniquement en cas de risque imminent pour un tiers (dans l’exemple extrême, lorsque le patient dit qu’il va tuer quelqu’un en sortant du bureau et qu’il a un couteau dans la poche). Dans cette affaire, c’est assez difficile à évaluer, surtout que je ne connais pas le contenu des entretiens, ni le comportement au sein de l’hôpital, et encore moins ce qui s’est passé durant ces 20 jours entre la sortie de l’hôpital et le passage à l’acte meurtrier… Mais un acte qui survient 20 jours après, ce n’est pas ce qu’on peut appeler « imminent ». Le patient lui-même savait-il qu’il allait commettre ce crime 20 jours plus tard ?
« Qu’est-ce que la décision du tribunal implique concrètement pour la profession ? »
La volonté d’univocité des diagnostic/traitement et la peur de tout risque ôtent toute respiration pour les travailleurs qui se frottent à des situations difficiles. Comme le dit l’avocat de la psychiatre : « les intervenants doivent-ils vivre dans la crainte d’être poursuivis pénalement parce que x jours après un entretien ou une sortie de l’établissement, la patient commet un acte délictueux ? »
Vous me demandiez où le travail du psy s’arrête : à celui des policiers, à celui des juges. La logique du tout sécuritaire tend à enfermer tout le monde : tous suspects ! Trouver un élément de dangerosité chez une personne n’est pas difficile. Chaque être humain porte en lui une potentialité violente. Il n’y a qu’à voir les avis des lecteurs sous les articles de presse en ligne : la violence verbale est omniprésente, le pire est souhaité non seulement pour les criminels mais pour la moindre star ou personne un peu en vue. Si toutes les personnes qui risquent de passer à l’acte étaient en prison ou enfermés de force en hôpital, les rues seraient vides ! Mais il est difficile d’envisager qu’on n’est pas en permanence en sécurité.
Nous vivons une certaine mutation. D’un côté, on doit bien constater que la justice vient à la place du champs psy : faute de places disponibles et de lieux de soin, les psychotiques se retrouvent en prison plutôt qu’en hôpital. Et, en retour, la justice demande aux psy de se substituer à elle. La logique sécuritaire fait qu’il est de plus en plus difficile d’obtenir des congés pénitentiaires et libérations sous surveillance électronique ou sous conditions. Un suivi psychologique est de plus en plus souvent exigé. Le psy extérieur est convoqué pour rassurer sur le risque de récidive. Je suis donc régulièrement amené à débuter des suivis psy sous contrainte avec des personnes qui ont fait de longues années de prison alors que, durant ce temps, rien n’a été fait en terme de traitement et de préparation à la sortie. D’un côté, la justice se substitue à la psychiatrie (traiter la personne), d’un autre, les psy sont convoqués à la place de la justice (juger et protéger). Ce brouillage des cartes est improductif et inadapté à la clinique des psychoses.

Magritte – Le thérapeute

J’ai travaillé durant 12 ans comme psychologue dans un service d’aide aux détenus (prisons bruxelloises de Forest, Saint-Gilles et Berckendael), aux ex-détenus (libération sous conditions, bracelet électronique, congés pénitentiaires, etc.) et à leurs proches.
J’ai créé ce blog pour rendre compte de ce que j’ai appris de ma rencontre avec les prisonniers.

 Intervenir en prison
Intervenir en prison À propos des prisons
À propos des prisons Des criminels / des délinquants
Des criminels / des délinquants Vous m’avez posé vos questions
Vous m’avez posé vos questions Les murs ont des oreilles
Les murs ont des oreilles Grand écran
Grand écran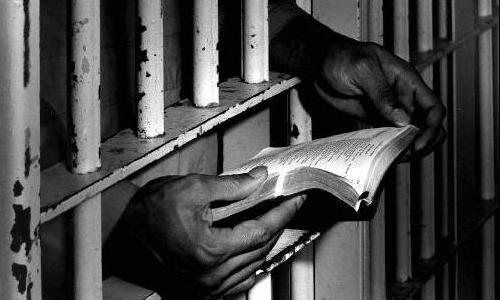 Poètes, vos papiers !
Poètes, vos papiers ! Images/humour
Images/humour Pourquoi ce blog ?
Pourquoi ce blog ? Me contacter
Me contacter D’autres blogs
D’autres blogs








“Il fallait bien punir quelqu’un”, laisser une famille “en suspend” c’est moche, alors là… c’est un peu mieux. c’est ce qu’ont pensé certains je suppose ?
Ce que tu dis est très important par rapport a la pression qu’on met de plus en plus sur les psys et inquiétant. en voulant trop bien faire, en refusant la moindre erreur de quiconque, ça déshumanise tout… et le résultat n’est pas mieux voir pire.
La recherche de la perfection (et pas que dans ce domaine là finalement) est ce que c’est une si bonne chose?
J’espère que cette femme va bien en tout cas..
Ton article est très intéressant.
Merci pour ton commentaire @oceane .
C’est toute la question : on peut avoir l’impression qu’en ne jugeant pas une personne, la justice n’est pas rendue, et donc une envie de vengeance, non prise en charge, symbolisée par la société, reste du côté des victimes.
Mais si interner quelqu’un n’est pas considéré comme une peine, ce n’en est pas pour autant une récompense. Le terme consacré est « mesure de protection ». La personne est d’ailleurs souvent enfermée plus longtemps que si elle avait été jugée, et une surveillance à la sortie est plus longue car à priori illimitée. Le problème, c’est peut-être le mot « irresponsable ». On peut est reconnu incapable du contrôle de ses actes, et donc être dit « irresponsable » juridiquement, mais on n’en reste pas moins responsable subjectivement. Pour Freud par exemple, on est incapable du contrôle de ce qui se passe dans nos rêves, nos symptômes ou nos actes manqués, pourtant on en est responsables, c’est-à-dire qu’éthiquement on a à en répondre.
C’est curieux cette impression que la responsabilité puisse glisser, nous sauter dessus à la première occasion ! J’ai plusieurs dizaines de patients qui sont libérés sous conditions, qui ont déjà commis des actes graves, dont certains sont sur le bord, eh bien j’imagine mal pouvoir être tenu pour responsable des actes de chacun d’eux ! Juger le psy « à la place » du fou peut avoir des conséquences terribles sur la pratique. En terme d’angoisse du côté du clinicien, de risque de glissement à un rôle plus policier, etc.
J’aime bien aussi ta réflexion sur la recherche de la perfection, qui ne serait peut-être pas la meilleure de choses, elle me fait penser au « meilleur des mondes » d’Aldous Huxley. En voici la préface :
Psychologue, et expert auprès du tribunal, je partage le fond de ton article; notamment sur les dérives d’une société qui 1) veut des coupables et 2) veut tout prédire (ce qui revient au même en fait)
Je regrette cependant la facilité avec laquelle tu traites l’approche cognitivo-comportementale d’idéologie, et les sous-entendus de facilité déshumanisante que tu lui prête. Certes, il existe des dogmes, des dérives idéologiques et des excès dans cette approche. . Bien sûr, on peut y trouver une volonté de tout expliquer quitte à ce que cela en devienne parfois ridicule. Mais ces dérives là se trouvent aussi dans la psychanalyse -que tu ne mentionnes jamais, mais à laquelle tu fais directement référence dans ton texte. Le nombre de pontes dont il est impossible de critiquer les interprétations et modélisations parfois farfelues, même longtemps après leur mort se comptent en nombre égal de part et d’autre me semble-t-il.
Enfin, et surtout, la « complexité » de la personne humaine devrait toujours nous garder humbles, mais pour autant ne jamais nous faire renoncer à nous y affronter et à chercher à mieux la comprendre. C’est je crois le rôle d’un expert que de s’affronter à la complexité, à chercher à comprendre ce qui est précisément très difficile à comprendre. Il s’agit notamment de rendre intelligible une situation qui pour un non-expert, fut-il juge, ne l’est pas, de permettre d’éviter que la Justice ne soit dans des dossiers aussi délicats, dominée par un certain « bon sens populaire ».
Merci @gilles-riou de m’avoir lu et pour tes commentaires qui vont me permettre de clarifier ma position.
Sur les TCC : en fait, je n’en ai pas parlé lors de l’interview. Je l’ai néanmoins rajouté lors de la rédaction de ce texte parce que je venais de discuter avec une amie qui se revendique des TCC et qui me tenait justement tout un discours de ce type : « l’être humain fonctionne comme un ordinateur ; on peut reprogrammer ses erreurs cognitives ; la psychose est une maladie du cerveau ; pour être une discipline scientifique il faut au praticien des arbres décisionnels, des évaluations quantitatives, etc ». Il y a là désubjectivation du côté du patient comme du côté du clinicien. J’ai donc nommé les TCC entre parenthèse alors qu’en effet tous les comportementalistes ne pensent peut-être pas comme ça. Mais surtout, je me rends compte que ça a eu pour effet de trahir un peu ma pensée à ce niveau là : dans cette affaire le problème ne se réduit pas pour moi à l’opposition TCC/psychanalyse. A ce propos, je ne suis pas le dernier à critiquer la psychanalyse ou certains psychanalystes, mais il me semble que la psychanalyse n’est pas en cause dans cette affaire précise, ni en effet les TCC, aucun article n’indique le cadre théorique du docteur Cavarelli, ni de l’expert-psychiatre.
J’ai plutôt essayé de mettre en avant une ligne de fracture dans l’approche éthique de notre profession, deux approches différentes de l’être humain, et donc aussi de l’expertise et des tests psychométriques. L’expertise vise à une certaine objectivation, mais c’est une chose de prendre en compte que c’est une tentative vouée à l’échec de part l’infinie complexité de l’humain, et c’en est une autre de croire qu’on a atteins à cette objectivité. Soit on pense que l’être humain est totalement prédictible (par des tests par exemple), ce qui a pour effet d’évacuer sa subjectivité, soit on considère qu’une part nous échappe, une part d’irréductible responsabilité du sujet. C’est un des risques de notre pratique : quand on se veut trop scientifique, on évacue le sujet (c’est même inhérent à la logique propre de la science) et on perd la part de risque, de pari, d’incertitude inhérente à la pratique thérapeutique. Dans le cas qui nous occupe, je critique l’idée d’une prédictibilité absolue d’un passage à l’acte à partir d’un diagnostic différentiel. Un schizophrène paranoïde peut passer à l’acte, mais pas tout le temps, pas automatiquement, ça dépend d’un certain contexte, de l’attitude du patient vis-à-vis de ses hallucinations par exemple. Et il suffit de faire un tour dans le centre-ville pour voir que nos rues sont remplies de schizophrènes paranoïdes. Il y a un risque inhérent à la liberté.
Et désolé si j’ai pu te sembler dés-expert-isant, mais ce n’était pas mon propos. Je ne mets pas la ligne de fracture entre les TCC et la psychanalyse, ni non plus entre le soin et l’expertise. Ce sont deux fonctions essentielles dans notre société. Du côté du soin aussi un fracture éthique existe : on peut soigner en se faisant partenaire du sujet ou au contraire en le contrôlant, en le soupçonnant, en le fliquant. Et dans les faits dont je parle, être soupçonneux envers une consœur qui pourtant avait la reconnaissance de ses pairs.
A propos, je te remercie d’avoir rendu justice au rôle de l’expert : « s’affronter à la complexité, à chercher à comprendre ce qui est précisément très difficile à comprendre. Il s’agit notamment de rendre intelligible une situation qui pour un non-expert, fut-il juge, ne l’est pas, de permettre d’éviter que la Justice ne soit dans des dossiers aussi délicats, dominée par un certain « bon sens populaire ».
C’est très clair, je reprendrai cette explication dans un prochain article si tu veux bien. Et au fait, tu serais d’accord de répondre à quelques questions pour le blog, sur la position de l’expert, sa fonction, les difficultés et impasses de sa pratique ?
Un avis n’est valable que si et sans condition, celui-qui l’émet sait de quoi il parle !
Je pense à ceux que j’ai eu à fréquenter ( les malades) , et aussi à ceux « normaux » qui sous l’emprise de leurs raisons ont dû répondre de faits parfois aussi incontrôlable … Fou ?
Comme beaucoup je crois que tant qu’il n’y aura pas de concertations de TOUS les concerné( e)s,, chacun( e) renverra la responsabilité sur le prétendu verrou de sécurité …
Ce qui est condamnable , vraiment condamnable et le manque de moyens ainsi que la place ou l’ont voudrait la résoudre ( /prison/récidive ).
Tant soit peu que cela soit prévisible après un passage en prison … Elle est l’école du crime , de la démerde et puisque personne ne vous fera de cadeau à la sortie , l’école de la récidive , à la vertu d’une nouvelle chance de réussite ! …. pour les normaux que l’ont emballent avec thérapeutes , analystes et encore plus de contraintes à venir … l’amalgame est facile ! Tous fou , tous à soigner , tous à contraindre !!! Pis c’a coûte bien moins aussi ! Et comme la construction de maisons de soins adaptés (et bien adapté à un humain malade )) aux plus délirants est transféré aux zonzons , normal que le serpent qui se mord la queue ai mal ! Un vrai travers sociétal.
Je l’aime pourtant notre société , et quand la constatation claire et sereine s’interpose sur un vécu , j’ai une réelle tristesse de voir autour de moi , combien de détresse , de misère , d’incompréhensions elle formate et je me demande qui sera celle/celui qui demain , pétera les plomb !
Comme Océane , je crains que vous les soignants de ce monde qui va mal , ne soyez contraints d’alourdir encore votre croix , que les choix ne soient plus analytiquement simple , car cette histoire de condamnation pèse forcément contre l’humanité ! Donc contre le risque d’avouer que vous travaillez dans un espace tellement faussé , que l’imprévisible n’ai plus de place !
Perso , donc dans le cadre d’une parole de plus , je trouve que la perversion de rendre femme/homme fou par les déséquilibre de notre société , est complètement mis de coté et qu’en fait cela arrange bien , il y aurait tellement de solutions là que de rendre notre monde moins menaçant et dangereux ne plairait pas puisqu’il faudrait y mettre beaucoup , beaucoup d’or !
Tandis que d’un coté , la construction d’établissement pénitentiaire devient par ces causes plus que nécessaire , de l’autre j’imagine fort bien pourquoi encore aujourd’hui il est facile de faire croire qu’elles sont et seront utiles ! tout devient sujet d’anormalité !
Une personne qui pète les plombs se fout pas mal de la prison , mieux encore , inconsciemment ou pas , elle l’a défie ! Alors imaginons ce que peut penser un « ayant déjà connu » !
C’est vous l’expert …
Avez vous des nouvelles de Danièle Canarelli ?
N’ayant point eu besoin de suivis médical quelconque , pendant et après ma libération , en étant encore à ce jour préservé , je pense volontiers que vos patient ( e)s ont malgré tout bien de la chance d’être accompagné( e)s par votre humanité ! merci du rappel !
Merci beaucoup pour tous ces commentaires, @reclusionnaire ! Je pourrais réagir à chacune de vos phrases, mais j’en garde l’inspiration pour mes textes futurs. 🙂
Alors oui, la société est foireuse, pousse-au-crime, normalisante et concentrationnaire à la fois, mais comme vous je l’aime. Est-elle notre symptôme?
Je n’ai pas de nouvelles de Danièle Canarelli, je pense qu’elle a fait appel du jugement. Affaire à suivre, donc.
Un autre texte qui en parle:
https://aveclacan.wordpress.com/2015/01/06/lindividu-dangereux/
pfff trop facile quand la société a besoin de coupables … il y a les psys les mères, les étrangers, et bien d’autres encore….
@bizoux …les femmes
J’ai lu ton article avec attention et me sens assez proche des idées développées, vu le travail que nous nous efforçons de mettre en place au sein de l’équipe mobile de psychiatrie. Beaucoup d’ intervenants avec qui nous collaborons ont cet idéal en tête: “vous qui travaillez en psychiatrie, vous savez!”. Et puis le modèle tombe un jour de son piédestal…
@sebastien Quand le modèle tombe de son piédestal, la clinique peut enfin commencer!
Petit HS : c’est fou comme une simple virgule peut totalement changer la signification d’un titre : “Lorsqu’un patient tue son psy, est-il responsable ?” :-)
@marc-olivier :p
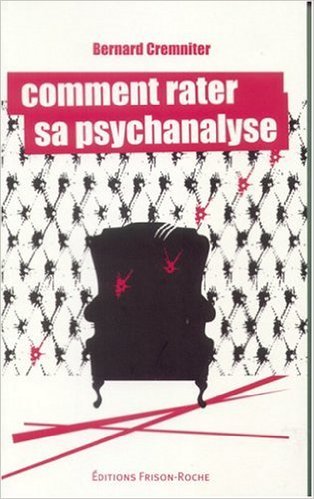
Tu connais déjà la date parution “papier”?
Déjà sorti, je dois encore le scanner…
Par contre, l’ai pas encore lu, peur de ce qui en a été fait! ^^ Exemple, le titre: “les psy sont-ils irresponsables?” !
le genre de truc que j’aurais bien gardé dans mes archives